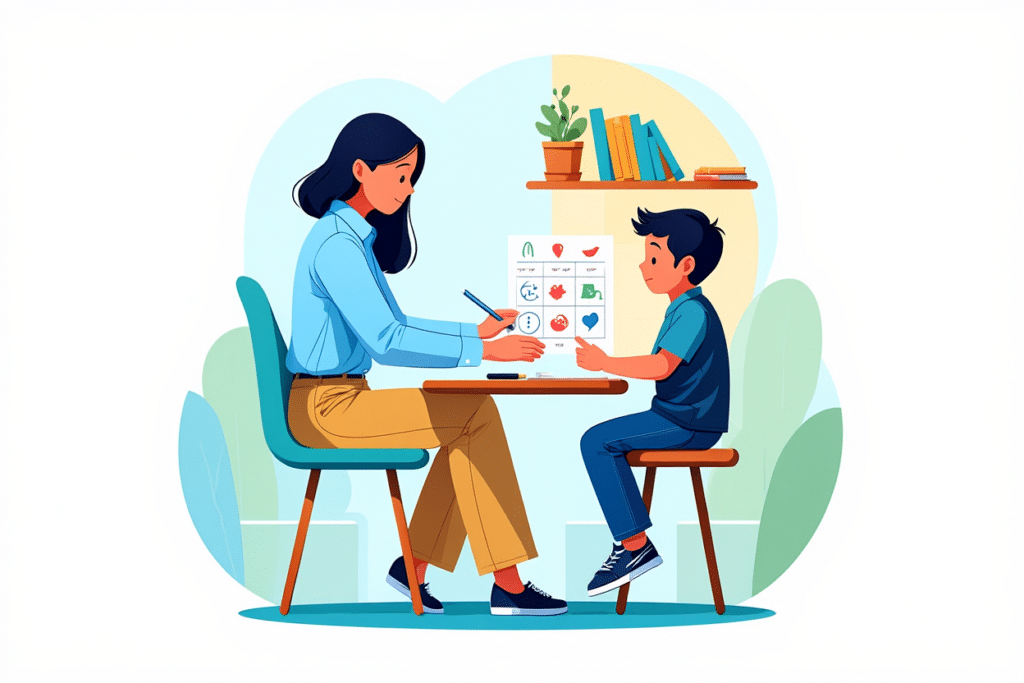L’essentiel en un coup d’œil :
La communication autistique est différente, pas absente : Elle peut être non verbale, atypique, fragmentée ou compensée. Il est essentiel d’adapter son regard et ses outils pour créer du lien sans a priori.
Des profils très variés : Chaque personne autiste présente un mode de communication unique. Certains n’ont pas de langage oral, d’autres parlent mais peinent à s’adapter aux codes sociaux.
Le rôle central du médecin généraliste : Il repère précocement les troubles, oriente vers les professionnels adaptés et accompagne les familles dans le parcours de soins.
Des outils existent pour faciliter les échanges : Communication alternative (CAA), pictogrammes, applications numériques, stratégies visuelles, repères sensoriels et soutien orthophonique sont essentiels.
Écouter et inclure : Respecter le mode d’expression de la personne autiste, c’est favoriser son autonomie, sa dignité et son inclusion sociale. Se former régulièrement est un levier indispensable pour y parvenir.
Le saviez-vous ?
Quand on pense à la communication, on pense avant tout au langage oral, aux mots.
Et pourtant, communiquer est bien plus que ça : c’est aussi l’attitude, les gestes, le regard, un sourire, une grimace, un mouvement de recul, les silences… tout ce qui permet de tisser du lien. Tout ce qui peut, chez une personne autiste, être perçu autrement, ou parfois manquer.
Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) implique, par définition, des difficultés d’interaction sociale et de communication. Mais difficulté ne signifie pas impossibilité. La communication est différente, mais reste possible et essentielle. Il faut simplement apprendre à en reconnaître les codes, à observer autrement, et à adapter notre posture.
Chaque enfant, chaque adulte autiste a son propre profil et ses propres ressources. Il n’y a pas « une » manière d’être autiste, pas plus qu’il n’y a « une » manière de communiquer. C’est ce qui peut compliquer l’accompagnement mais aussi le rendre à la fois riche et passionnant.
Alors de quels outils disposez-vous pour entrer en contact, créer un lien, faciliter l’expression, éviter les malentendus et soutenir l’inclusion de vos patients autistes ?
C’est ce que nous allons explorer ensemble.
Les particularités de la communication dans l’autisme
L’autisme, c’est parfois le mutisme ou une difficulté à cerner l’intention de communication, c’est aussi avoir du mal à comprendre le langage corporel ou à se concentrer sur une conversation …
Alors absence de langage oral, langage fluide mais atypique ou langage conceptualisé et restreint, chaque enfant autiste rencontre ses propres difficultés de langage, d’apprentissage et de communication. Et ce sont ces différents profils autistiques qu’il faut observer, comprendre et avec lesquels il faut composer pour pouvoir personnaliser le suivi et individualiser la prise en charge.
Les difficultés verbales fréquentes
Les troubles du langage :
Certains enfants ne développent pas ou très tardivement le langage oral. Mais si le langage expressif est parfois absent, le langage réceptif, lui, peut être présent.
Parmi les particularités les plus fréquentes, on retrouve :
- Un retard ou une absence de langage: parfois compensé par d’autres moyens (gestes, pictogrammes).
- Une écholalie: répétition immédiate ou différée de mots ou de phrases, souvent extraite de contextes connus (dessin animé, dialogue parental…). Elle peut avoir une fonction (apaiser, demander) ou être automatique.
- Un langage « professoral »: très formel, soutenu, parfois technique, sans prise en compte du contexte relationnel.
- Un pragmatisme déficient: difficulté à adapter son discours au contexte (second degré, ironie, implicite, tours de parole…).
- Des difficultés à entamer, maintenir ou conclure une conversation.
Les spécificités de la communication non verbale
L’autisme peut aussi affecter l’usage ou la compréhension des codes non verbaux :
- Peu ou pas de contact visuel.
- Expressions faciales absentes ou peu lisibles.
- Ton de voix inhabituel (monotone, chantant, robotique…).
- Gestes rares ou inadaptés (absence de pointage).
- Difficulté à comprendre les postures, les expressions des autres ou les distances sociales.
Des habiletés clés comme l’attention conjointe (regarder la même chose en même temps), l’imitation ou les tours de rôle, essentielles dans les échanges verbaux, sont souvent perturbées.
La communication sociale : les interactions interpersonnelles
Les échanges peuvent être difficiles à initier, maintenir ou conclure. La conversation peut tourner autour d’intérêts spécifiques, avec un risque de retrait ou, au contraire, de monopole de la parole.
La communication avec un enfant autiste demande une certaine exigence et du temps, mais elle est d’une richesse étonnante. Fidélité, franchise et sincérité s’y côtoient. Loin des codes sociaux ordinaires, les personnes autistes sont d’une authenticité rare dès lors qu’elles vous font confiance.
Particularités sensorielles et communication :
L’hypersensibilité auditive, visuelle, tactile ou olfactive peut parasiter la relation. Trop de bruit, trop de lumière, trop de stimuli… et c’est le blocage. Ce repli est souvent perçu à tort comme un refus d’entrer en relation ou de communiquer.
Intérêts spécifiques :
À l’inverse, les intérêts spécifiques, parfois très ciblés, peuvent être d’excellents vecteurs de communication, et les sujets, quand ils sont valorisés, sont de puissants leviers d’échange : météo, plans de métro, mode, littérature moderne ou histoire.
Variabilité interindividuelle importante
Certains enfants ne parlent pas mais communiquent très efficacement avec des gestes ou des pictogrammes.
Tandis que d’autres ont un langage développé mais des difficultés pragmatiques marquées. Chaque personne a son profil de communication à identifier pour mieux cibler les actions à mettre en place.
Comprendre l’impact de ces difficultés sur la vie quotidienne
Ces difficultés de communication impactent fortement le quotidien :
- À l’école, elles sont sources de malentendus — y compris avec les enseignants —, contraignent à l’isolement, et induisent des troubles du comportement en réponse à la frustration.
- En consultation, l’enfant peut rencontrer des difficultés à exprimer une douleur, un malaise. Le diagnostic peut être retardé.
- Dans la vie sociale, elles entraînent exclusion, rejet, incompréhensions, et majorent le stress.
- Dans la sphère familiale: les proches peuvent se sentir impuissants, éprouver des difficultés à comprendre les besoins de leur enfant, et parfois, culpabiliser.
Comment repérer les troubles de la communication en médecine générale ?
En tant que médecin traitant, vous occupez une position stratégique : vous êtes souvent l’un des premiers professionnels à entrer en contact avec l’enfant et sa famille.
Vous suivez l’évolution, observez, rassurez, orientez, alertez. Vous êtes même parfois le seul repère fixe dans un parcours éprouvant, souvent ponctué d’attentes, d’incertitudes ou de diagnostics erronés.
Vos principales missions sont de :
- Repérer précocement
Votre regard clinique est important pour alerter et orienter rapidement, alors que ce soit lors des consultations de routine ou lors des visites obligatoires, soyez attentif à :
- L’absence de babillage ou de pointage à 12 mois.
- L’absence de mot à 18 mois.
- Le retrait social ou affectif.
- L’absence de réaction au prénom.
- Les comportements inhabituels (alignements, fixations, refus du contact, pas de jeux symboliques, réponses décalées…).
- La régression continue d’une des compétences.
Utilisez des outils validés comme le M-CHAT ou les grilles proposées par la HAS dans son guide de repérage précoce.
- Orienter rapidement
En cas de doute, orientez sans attendre vers un Centre Ressource Autisme (CRA) ou un spécialiste (pédiatre, pédopsychiatre, orthophoniste).
Rappelons que la plasticité cérébrale est maximale avant 6 ans. Plus le diagnostic est précoce, plus tôt l’enfant est pris en charge, et plus les apprentissages sont efficaces.
- Guider les familles :
- Informez et éduquez les familles.
- Soulignez l’importance d’une prise en charge pluridisciplinaire.
- Rassurez : expliquez que chaque autisme est différent, et que le diagnostic n’est pas une étiquette mais un levier d’accompagnement.
- Encouragez à consulter les associations et plateformes fiables.
Adapter sa communication face à un enfant ou adulte autiste
Votre propre mode de communication est important. C’est même la clé d’un examen clinique réussi.
Posture relationnelle et verbale
Les principales consignes à appliquer pour une communication réussie sont de :
- Se placer à la hauteur de l’enfant pour favoriser l’échange.
- Parler lentement, utiliser des phrases courtes et un vocabulaire concret.
- Éviter l’ironie, les sous-entendus et tout ce qui est implicite.
- Laisser du temps à l’enfant pour traiter l’information et répondre, éviter les doubles consignes.
- Ne pas interpréter les silences ou l’absence de regard comme du désintérêt.
L’environnement compte aussi
Si la posture et le langage sont importants, créer un environnement propice à l’échange et à la confiance est tout aussi indispensable.
Pour créer cet environnement enveloppant, veillez à :
- Réduire les stimuli inutiles (bruits, lumières vives).
- Planifier et préparer la consultation en amont avec les parents : déroulé de la séance, photo du cabinet, pictogrammes des étapes, routines.
- Utiliser des repères visuels.
- Répéter, reformuler, rassurer.
- Valoriser et féliciter l’enfant à chaque tentative de communication, même minime.
Quels outils pour favoriser la communication ?
Tableau récapitulatif des stratégies de communication à adapter :
À faire : | À éviter : |
Se mettre à hauteur de l’enfant. Parler lentement. Utiliser des phrases simples, claires et concrètes. Annoncer ce qu’on va faire à l’enfant (ex : « je vais regarder ta gorge »). Laisser un temps de réponse suffisant. Utiliser des supports visuels (dessin, schéma, pictogramme, planning), des jeux et les outils alternatifs (CAA). Accepter l’absence de contact visuel. Encourager et féliciter l’enfant. | Parler debout, en hauteur. Utiliser des phrases longues, complexes. Éviter les sarcasmes, le second degré, les sous-entendus, les changements brusques de sujet et les injonctions contradictoires. Procéder directement à l’examen clinique. Poser une question et enchaîner sans attendre la réponse. Se contenter du langage oral. Interpréter le regard fuyant comme un manque de respect ou un refus de communiquer. |
Communication alternative et augmentée (CAA)
La communication améliorée et alternative (CAA) fait partie des outils de référence à intégrer dans votre pratique pour favoriser et entretenir les échanges avec vos patients autistes. On retrouve essentiellement :
- Le PECS (Picture Exchange Communication System) : échange d’images pour demander, commenter, choisir.
- Les Pictogrammes, les livres de communication et les tableaux visuels.
- Le programme Makaton, qui utilise les gestes et ressemble à une langue des signes adaptée.
Les outils de la CAA permettent de s’appuyer sur les compétences présentes pour en enseigner d’autres (système de renforçateur).
Les approches comme TEACCH, ABA, ou Denver peuvent structurer les apprentissages, selon les profils.
Applications et outils numériques
Enfin, certaines applications vous aident à composer des phrases avec des images ou des pictogrammes. Elles peuvent vous aider à entrer en relation avec l’enfant.
Les plus utilisées sont : LetMeTalk, Avaz AAC, SymboTalk, Proloquo2Go.
Elles ont l’avantage d’être portables, personnalisables et favorisent l’autonomie.
Orthophonie et interventions précoces
Spécialiste des troubles de la communication et du langage, l’orthophoniste est un acteur-clé de l’accompagnement de l’enfant autiste. Formé aux outils alternatifs, il peut établir un bilan orthophonique pour évaluer les compétences.
Il aide l’enfant à développer ses compétences en lui permettant de travailler la communication fonctionnelle (faire une demande, refuser, commenter…), et de développer le langage oral (former une phrase, parler plus spontanément, varier le vocabulaire…).
Il s’adapte aux profils (non-verbal, hyperlexique, troubles associés…).
Stratégies sociales et interactions structurées
Enfin, il est impératif de développer les compétences sociales de l’enfant autiste :
- Groupes d’habiletés sociales: apprendre à dire bonjour, écouter, attendre son tour, comprendre les émotions.
- Jeux de rôle, scénarios sociaux.
- Valoriser les intérêts spécifiquespour créer du lien.
- Encourager chaque tentative de communication.
Le rôle des familles et des professionnels
Pour que l’accompagnement soit réussi, il est impératif d’impliquer tous les intervenants de manière cohérente : médecins, soignants, éducateurs, mais aussi et surtout les familles.
Il s’agit surtout :
- De soutenir : routines, pictogrammes, anticipation.
- D’observer les signes de communication atypiques (regard, geste, posture).
- D’intégrer des professionnels qualifiés précocement (psychologues spécialisés, éducateurs).
- D’harmoniser les pratiques entre professionnels.
- De former les aidants (parents, AVS, enseignants…) à l’utilisation des outils visuels ou numériques.
Donner la parole aux personnes autistes elles-mêmes
Ce n’est pas parce que la personne autiste rencontre des difficultés pour communiquer qu’il faut l’en priver. Lui redonner la parole, c’est aussi l’inclure et le respecter en tant qu’être humain à part entière.
Lui seul sait ce qui lui convient. Respecter son mode d’expression est fondamental.
Certains préfèrent l’écrit, d’autres le visuel ou le geste. Ce choix doit être un droit, parce que favoriser l’autonomie dans la communication, c’est favoriser l’inclusion sociale.
Ressources, accompagnement et formations
Pour vous aider dans votre quotidien et sécuriser vos pratiques, n’hésitez pas à :
- Orienter vos patients vers les professionnels de santé experts (psychologues, orthophonistes, IME, CMPP, SESSAD, CRA…), notamment en cas de doute.
- Travailler avec les associations locales spécialisées : SATEDI, AFFA, Autisme France, Aspie-Friendly, etc.
- Utiliser les plateformes de ressources : livret CNSA, visuels à télécharger (Papouille, Arasaac, Makaton).
- Vous former : MOOC Autisme, formations DPC, webinaires spécialisés.
À retenir : En tant que médecin généraliste, votre rôle consiste à : • Écouter sans préjuger. • Faciliter les parcours. • Valoriser les progrès. • Prévenir les impasses médicales (diagnostic erroné —notamment psychiatrique—, qui masque parfois un TSA non identifié, et entraîne un retard de soins).
Pour vous aider dans cette mission, vous pouvez vous appuyer sur : • Votre intuition clinique, parfois plus fine qu’un test. • Les parents, qui connaissent mieux leur enfant que quiconque. • Les recommandations HAS (diagnostic TSA 2022, repérage précoce). • Les réseaux de soins : orthophonistes, psychologues, pédopsychiatres, psychomotriciens, ergothérapeutes. • Les associations qui proposent des outils concrets (Papouille, Arasaac, Satedi…). • Les formations continues (MOOC Autisme, DPC, webinaires spécialisés). |
Pour conclure...
La communication des personnes autistes est certes singulière, mais jamais absente ou dénuée de sens. Elle doit être interprétée, soutenue, adaptée.
Plutôt que de vouloir la normaliser, nous devons apprendre à décoder leur manière unique de s’exprimer, et s’y adapter pour les inclure pleinement dans notre société.
Pour relever ce défi, il faut observer, écouter, soutenir, et valoriser.
Bien sûr, entrer en relation avec une personne autiste n’est pas inné. Y compris quand on est soignant. Mais, il existe différentes ressources pour vous aider à développer ces compétences : associations, plateformes et … la formation continue, qui complète votre formation initiale et vous donne les outils pour mieux repérer les signes évocateurs du TSA et mieux communiquer avec vos patients autistes.
Prenez-vous en charge des patients autistes ?
Rencontrez-vous des difficultés communicationnelles ?
Quelles astuces employez-vous pour entrer en relation avec ces patients neurodivergents ?
Enfin, si vous avez trouvé cet article utile, n’hésitez pas à le partager autour de vous.
Articles similaires :
- Autisme chez l’enfant : repérage précoce et rôle du médecin généraliste
- Autisme : Comprendre les causes pour mieux orienter le diagnostic en médecine générale
- Autisme chez la femme : mieux comprendre pour mieux repérer
- Cancer chez l’enfant : symptômes à surveiller, démarches diagnostiques et rôle du médecin généraliste